
Article de Stéphane Offort – décembre 2024
Neuroscience, méditation et psychédéliques : plongée dans la conscience humaine
Londres, ville mythique où se mêlent histoire et modernité. Mais mon voyage il y a 1 mois n’avait rien à voir avec Big Ben, ma nostalgie du punk rock ou la famille royale. Je m’y suis rendu pour une raison bien plus fascinante : plonger dans les méandres de la conscience humaine en collaborant avec l’Imperial College of London. Ces recherches combinant neurosciences, méditation et psychédéliques m’ont offert une opportunité rare de participer de nouveau à des études sur la conscience.
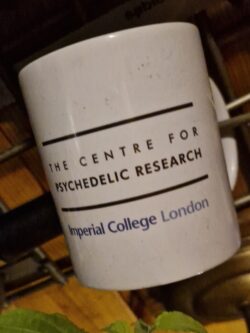
Tout a commencé un beau matin d’octobre 2017
En octobre 2017, j’ai été contacté pour participer à des recherches en neurosciences à l’INSERM.
Celles-ci se sont déroulées en mai 2018 au centre de recherches de l’Inserm près de Lyon.
C’était la première fois que je rencontrais Antoine Lutz. Pendant ces recherches, j’ai passé une semaine à participer à différentes recherches organisées par des étudiants en doctorat ou postdoc sous la tutelle d’Antoine.
Nous avons pu échanger sur plusieurs sujets et toute l’équipe était vraiment ouverte et impliquée dans ces recherches sur la méditation.
Ce fut une très belle rencontre qui a continué à se développer dans le temps lorsque Antoine m’a recontacté un an et demi après pour me demander si je voulais bien participer à l’élaboration et à la mise en place d’une étude qui s’est appelée LONGIMED.
L’étude LONGIMED était une première, je ne sais pas si je pourrais dire mondiale, mais en tout cas une première en Europe, qui était d’étudier l’effet de la méditation avant, pendant et après une retraite de dix jours. Mon intervention dans cette étude a été de voir comment mettre en place la retraite selon ce que les chercheurs, et dans ce cas celui qui dirigeait l’étude était Arnaud Poublan-Couzardot, souhaitaient réellement étudier et observer, et de voir avec eux quels types de pratique mettre en place au cours de la retraite.
Ma participation m’a amené à guider trois retraites de dix jours. Pendant ces retraites, avant il y avait une étude en imagerie cérébrale, puis sur les comportements, pendant la retraite et après la retraite.
Cela a été extrêmement intéressant pour moi de collaborer à la mise en place de cette étude et de travailler avec des neuroscientifiques à nouveau.
Continuer l’engagement dans les recherches en neurosciences
Il y a à peu près un an et demi, Antoine m’a recontacté en me proposant de participer à une étude portant sur un sujet dont nous avions déjà discuté lors de l’étude Longimed, à savoir les effets des substances psychotropes.
Il y a des recherches qui sont faites lors de sessions d’utilisation de psychédéliques. Ces sessions sont très contrôlées au niveau des substances utilisées, des dosages, et aussi la présence de personnes qui sont capables d’assister les participants rencontrant des difficultés.
Il y a aussi des recherches portant sur la méditation et les psychotropes.
Par exemple, je me souviens que lors de l’étude Longimed, Antoine m’avait montré les résultats d’une étude faite sur des pratiquants Zazen. Lors d’une retraite d’une semaine, on leur avait donné un placebo et d’autres une micro-dose de psychédélique (je ne me souviens plus lequel exactement) afin de voir si cela avait une interférence avec leur méditation et leur expérience de méditation.
Antoine m’a ensuite proposé d’échanger avec un neuroscientifique de l’Imperial College of London, Christopher Timmerman, qui s’est orienté dans cette recherche pure en neurosciences et psychédéliques. En ce moment, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur l’utilisation des psychédéliques dans le cas de dépression, des traumatismes, voire des addictions. Là, il ne s’agit pas vraiment de l’aspect clinique et utilitaire, mais plutôt de voir comment les psychédéliques agissent sur la conscience et arriver à comprendre les effets qu’ils ont.
Bien sûr, on sait quel genre de molécules agissent, quels neurotransmetteurs sont impliqués, etc. Mais que se passe-t-il vraiment lors des expériences qui surviennent lors de la prise de psychotropes?
Quelles relations entre psychotropes et méditation?
Antoine Lutz m’a présenté à Christopher et nous avons commencé à discuter sur les expériences que beaucoup d’utilisateurs des psychotropes ont pu observer, à savoir une expérience de non-dualité où le soi se dissout totalement et la sensation d’une forme de présence lumineuse, une conscience lumineuse infime et l’impression qu’il n’y a plus de dualité.
La proposition de cette expérience était de voir quels seraient l’expérience et le point de vue d’un méditant pour la comparer à l’expérience d’un utilisateur sans expériences préalables de méditation.Est-ce que l’expérience de quelqu’un qui a un entrainement poussée à la méditation est similaire ou différente dans sa profondeur et dans sa qualité lorsqu’il est sous l’emprise d’un psychotrope?
La substance utilisée est le 5-Meo-DMT (5-Methoxy Dimethyltryptamine), qui est une substance issue d’un crapaud, le fameux bufo alvarius ou « crapaud-buffle », qu’on retrouve très souvent dans le désert de Sonora, aux Etats-Unis. Cette substance existe à l’état naturel sous forme d’un venin. Elle est utilisé par les chamans pour entrer dans des états modifiés de conscience et pouvoir contacter des expériences, des entités, etc. Lorsque ce venin est chauffé, toutes les toxines sont neutralisées. Il est alors fumé ou inhalé et devient un psychotrope très actif. Il est apparenté au DMT, son effet est très rapide et de courte durée.
Nous avons eu beaucoup d’échanges sur le sujet et quel protocole de recherches pouvait être mis en place.
Les recherches qui étaient faites par Christopher jusqu’à maintenant étaient principalement avec des gens qui avaient l’habitude d’utiliser les psychotropes.
Prenant pour base les témoignages des “psychonautes” (personnes explorant leur expériences et leur consciences au travers de l’utilisation de substances psychotropes) Christopher souhaitait voir si mon expérience de méditation, avec ou sans substance, était la même, et qu’est-ce qui se passait exactement, comment je le percevais par rapport à une expérience de méditation, on va dire, avancée ou profonde.
Première expérience et exploration
L’étude s’est déroulée en plusieurs temps.
Pour chaque séance, je devais être soumis à un électroencéphalogramme que j’allais garder toute le journée.
Le déroulé de chaque session était le même. Tout d’abord, un état sans méditation, puis un état de comptage à partir de mille à rebours d’unités de cinq, donc 1000, 995, 990, et ainsi de suite.
Ces deux « situations » permettent d’avoir des enregistrements EEG liés soit à un état sans réflexion particulière et avec du vagabondage mental, soit avec une tache demandant une concentration aiguë. Cela permet de comparer les enregistrements entre un état de conscience ordinaire, de la méditation et une expérience avec les psychotropes.
Ensuite, je devais m’engager dans une pratique méditative avec quelques signaux verbaux, où j’expliquais d’abord en quelques mots succincts ce que j’étais en train de faire, puis, lors de la méditation, j’indiquais par un signal verbal (oui ou non), si j’étais dans une expérience “profonde” de méditation.
Cette première partie se terminait avec un questionnaire de micro phénoménologie.
Dans le deuxième phase de la séance il y a eu la prise de la substance, l’expérience, et après l’expérience un autre questionnaire de micro phénoménologie.
Cette prise de la substance par spray nasal était un test à l’aveugle: il y avait un sachet sans aucune indication, est-ce que c’est un placebo? est-ce que c’est la substance à faible dosage? ou est-ce que c’est une substance à dosage fort? Le dosage faible est à 5 mg, le fort à 12,5mg.
Tout se passait dans une pièce de l’hôpital de l’Imperial College of London. C’est une chambre d’hôpital mais ils ont essayé de l’arranger et de lui donner un air plus “chaleureux” comme vous pouvez le voir sur cette photo.
Le premier jour, j’ai fait une méditation. J’étais assez fatigué parce que j’avais voyagé la veille et eu beaucoup d’activités pendant les 3 mois qui ont précédé, mais ça s’est quand même bien passé. Les chercheurs ont ensuite mené une l’interview de micro phénoménologie comme une exploration de mon expérience. Ce qui m’a intéressé dans cette approche c’est la ressemblance avec le dialogue exploratoire. C’est une technique d’exploration utilisée dans le monde de la peine consciente, par exemple dans le MBSR, pour explorer ou amener les participants à explorer leur expérience. Il s’agit de questions précises toujours en relation avec l’expérience décrite et dans une véritable approche guidée par la curiosité.
C’est d’abord James, qui fait partie de l’équipe de recherche, puis Christopher, qui ont mené l’entretien. Les questions essayaient d’aller en profondeur: quelle a été l’expérience? qu’est-ce qui a été ressenti? comment c’était juste avant? comment c’était après? et ainsi de suite. C’est très profond, et en même temps très ouvert. Ils prennent les informations, ils questionnent, ils explorent le questionnement, mais c’est surtout pour récolter les informations et pour que ce soit le plus neutre possible, vraiment venant de l’expérience du participant.
Ensuite est venu le moment de la première dose, la première expérience. Cinq minutes après avoir reçu la première dose par spray nasal, c’était clair que c’était le placebo, donc on a arrêté là.
Deuxième séance
Lors de la deuxième séance, toujours à l’aveugle, j’ai reçu la dose faible. La séance suivait le même mode opératoire que la séance précédente Après le questionnaire micro phénoménologique sur la session de méditation nous sommes passé à la deuxième phase. J’ai pris place sur le lit pour me préparer à recevoir la seconde dose.
Tout d’abord sont apparues des sensations dans le corps.
Un point important est que cette substance ne donne pas d’hallucinations visuelles. Il peut y avoir des images qui peuvent apparaître mais ce n’est pas comme le DMT ou le LSD, où on va vraiment avoir des hallucinations d’ordre visuel ou auditif. Ici il s’agit d’étudier ce qui se passe dans la conscience et la conscience du soi.
Cette faible dose a provoqué des sensations corporelles assez particulières, quelques images mentales mais rien de particulièrement intense.
Je voyais très bien que mon expérience se modifiait mais il n’y avait aucun changement au niveau de l’état de la conscience.
J’étais dans un état d’attention, de pleine conscience habituelle. Sans rentrer dans les détails, dans la méditation, dans le cadre bouddhiste, on va un peu plus loin que juste la pleine conscience. La méditation consiste à s’établir dans la « nature de l’esprit », c’est-à-dire reconnaître exactement de quoi la conscience est faite. Quelle est la véritable nature de la conscience ? Ce serait vraiment la meilleure manière de le formuler.

Troisième séance, là commence l’aventure.
Lors de la troisième séance j’ai reçu la dose plus forte.
James, qui était présent, m’avait expliqué ce qui allait se passer, comment ça se déroulait, et les phénomènes qui pouvaient se manifester.
Pour certaines personnes, il peut y avoir une forme de panique qui se met en place au début de l’expérience.
D’un côté j’avais James et de l’autre il y avait une professionnelle de santé, “a medic” en anglais, Veronica, et Christopher qui surveillait l’électroencéphalogramme et tout ce qui se déroulait. À tout moment, il y avait la possibilité si je sentais une forme de peur ou de panique de tendre la main pour entrer en contact avec l’un d’entre eux et pour qu’ils puissent peut-être me rappeler de respirer ou simplement rassurer par un contact. Je n’ai pas eu besoin de ça.
Il faut savoir que dans cette prise de substances, très souvent, il y a une période où il peut y avoir des nausées, voire des vomissements, sans que ce vomissement soit perçu par les participants comme désagréable. C’est plutôt comme quelque chose qui permet à l’expérience de se développer.
C’est ce qui s’est passé pour moi aussi. Par rapport à la prise de substances faible, j’ai très rapidement senti des effets comme des changements dans la respiration, dans le rythme cardiaque, et aussi une espèce d’effacement des expériences sensorielles.
C’était un peu comme, lorsqu’on a l’habitude de méditer, de continuer à méditer tout en tombant de sommeil. On peut voir avec l’expérience que les sens, les expériences sensorielles s’évanouissent. On se retrouve plus au niveau de la conscience directement.
A un moment lors cette expérience, j’ai eu la sensation d’être extrêmement conscient, clairement présent, de ne plus avoir de contact avec le corps ni avec l’environnement, et donc de ne plus ressentir la respiration. Je comprends pourquoi chez certaines personnes cela peut créer un moment de panique où ils ont l’impression qu’ils ne respirent plus alors qu’en fait leur corps continue de respirer. Ensuite est apparue cette expérience de luminosité sans limite, telle que certaines personnes la décrivent.
Il y a aussi des réactions corporelles qui se mettent en place, et ça, ça dépend des gens. Donc il y avait des allers-retours comme ça, entre percevoir les mouvements du corps, voir même des sons qui étaient produits, et revenir dans un état de luminosité sans limite.
En fait, il y avait toujours un mode de dualité, même si c’était très subtil, avec toujours une conscience de l’expérience. C’est vrai qu’il y a une sensation d’infini, d’être sans limite plutôt, cette lueur blanchâtre, cette luminosité un peu blanche. L’effet du produit dure à peu près 45 minutes. Mon ressenti subjectif était que cela avait duré 10 ou 15 minutes, mais non, ça a duré 45 minutes. Une fois que c’est fini, c’est fini. Il peut y avoir une forme de fatigue physique, mais c’était totalement fini. Il n’y avait plus rien. Plus aucune trace de la substance, plus aucun effet.
Alors non-dualité ou dualité?
Il est clair que ce que je partage ici est subjectif et simplement basé sur mon expérience de méditant.
Dans cette expérience de luminosité infinie, il y avait toujours une conscience de l’expérience, même si elle était très subtile. Et cela m’amène à ne pas considérer l’expérience comme une expérience de non-dualité. Le sujet est là, mais très très subtil. Il y a toujours une conscience de la luminosité, donc un aspect subtil de dualité.
Ce qui était intéressant dans cette expérience, c’est de voir qu’ il y a des effets qui, on va dire, sont similaires à des expériences de méditation profonde, par exemple la perte de temporalité. On ne sait plus exactement combien de temps cela dure. Des moments où on ne va peut-être plus être en contact avec le corps et la respiration. Et cette expérience de luminosité, je peux très bien imaginer que des gens qui ne pratiquent pas la méditation de manière poussée peuvent avoir l’impression que c’est de la non-dualité.
Lors d’échanges que nous avons eu avec Antoine, Christopher et John D. Dunne, nous sommes arrivés à la conclusion que la reconnaissance de la « qualité » de cette expérience de luminosité sans limite avec une conscience « pure » peut donner l’impression qu’il y a une forme de non-dualité infinie, où tout est là, et en même temps, rien n’est là, si le participant n’a pas d’entrainement poussé de la méditation. Ce qui est le plus saisissant dans cette expérience c’est l’absence d’un « soi narratif » et c’est surement ce qui donne cette impression de non dualité, d’une conscience pure infinie sans le soi. Même pour un méditant expérimenté cette expérience peut être mal interprétée au début et c’est en la faisant encore et encore qu’elle est reconnue et vue comme une expérience restant toujours dans le domaine de la dualité. L’absence du soi narratif est un état sans pensées, sans réflexion, sans cet habituel aller-retour entre le sujet et l’objet qui existe dans toutes nos fonctionnements. Ici il est induit par la substance mais cela nous montre que la conscience même dualiste existe d’une manière très très subtil mais profonde sans « notre » aide. Nous pourrions presque définir cette expérience comme le « moi » profond, primordial.
Dois-je continuer la méditation?
Toutes les recherches qui ont été faites jusqu’à maintenant, par rapport à l’utilisation des psychotropes avec la méditation, c’est que les gens qui ont l’habitude de méditer, qui sont des méditants réguliers, lorsqu’ils font l’expérience d’une substance psychotrope, disent que ça ne change rien. C’est-à-dire qu’une fois que l’effet de la substance est passée et qu’ils méditent, il n’y a aucune différence. Ça n’a aucun effet, ni en plus, ni en moins. Il n’y a pas de traces ni de ressentis physiques ou mentaux qui restent après coup.
Ce fût aussi la mienne. En fin de séance, j’ai de nouveau fait une séance de méditation sans percevoir de changement. Et même à ce jour où j’écris ces lignes il n’y a eu aucun changement dans ma pratique. Cela va à l’encontre de ce certains peuvent croire, à savoir que la prise d’une substance psychotrope va les aider à entrer en état de méditation.
Ce qui m’a été aussi notifié c’est qu’il y avait beaucoup plus de changements clairs dans les enregistrements de l’EEG lors de la méditation que lors de la prise de 5-Meo-DMT. C’est intéressant de voir que la méditation amenait à différents états de conscience et de fonctionnement au niveau du cerveau que n’amènent pas la prise de psychotropes!
Donc voilà, c’était un peu pour vous expliquer pourquoi j’étais allé à Londres, qu’est-ce que je faisais là-bas. Comme disait ma compagne en rigolant, “ben tu vas être payé pour aller faire de la recherche scientifique en prenant de la drogue”!
Ça a été intéressant de travailler de nouveau avec des neuroscientifiques, je sais que c’est quelque chose qui me stimule énormément. Nous avons eu beaucoup d’échanges aussi avec Christopher par rapport à la méditation et aux études sur les psychédéliques.
Ce qui est ressorti très clairement, c’est que la prise psychotrope ne remplaçait pas la méditation, et personnellement je ne pense pas qu’elle soit un substitut à la pratique, et qu’elle amène, même avec des doses importantes et régulières, à une expérience qui soit la similaires à celle de quelqu’un qui pratique même 20 minutes ou 40 minutes par jour. En conclusion, je pense qu’il y a une grande différence entre s’entraîner tous les jours à développer la pleine conscience et prendre une substance pour avoir une expérience qui va durer juste un moment, et qui ensuite va disparaître.
Il y a aussi l’aspect de la motivation. Quelle est notre motivation ? Est-ce que c’est pouvoir, excusez l’expression, « s’envoyer en l’air » d’une manière méditative, ou est-ce que c’est vraiment de développer certaines qualités qui sont inhérentes à notre être et ensuite pouvoir peut-être partager, ou en tout cas amener une certaine bienfait autour de nous, à travers ces qualités?
Dans un proche avenir, je souhaite organiser des interviews avec certains neuroscientifiques pour voir un peu qu’est-ce qu’ils ont mené comme recherche par rapport à la pratique de la méditation, qu’est-ce qu’ils ont vu, qu’est-ce qui a été perçu, et comment ils voient l’utilisation de ces résultats, et vers quoi ils aimeraient aussi continuer peut-être à travailler par rapport à tout cela.
Et je vous amènerai avec moi pour explorer tout cela!
Stéphane Offort


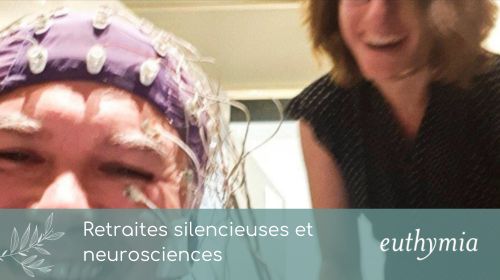
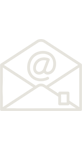

4 commentaires
Les ministères de l’éducation et de la jeunesse pourraient comprendre de cette expérience la nécessité de faire entrer la méditation dans les écoles dès le plus jeune âge , cela éviterait peut être une partie des PB de drogue des adolescents. Bravo Stephane pour ton implication, et ton récit m’a beaucoup intéressée
Merci pour ton témoignage Stéphane ! C’st super de te lire et d’autant plus sur le sujet qui est classique dans les croyances populaires new age.
Excellentes fêtes !
Maxime
Merci pour ce passionnant témoignage ! Qui confirme s’il en était besoin la confiance que j’ai dans ta guidance.
Merci Stephane pour ce temoignage. Je m’interesse aussi à cette relation entre psychadelique et meditation, ou psychadelique et spiritualité. Les ouvrages d’Albert Hoffman, sur la nature de la réalité, La sagesse interdite ou Psychédéliques entre science et spiritualité d’Olivier Chambon et Stephane Shillinger